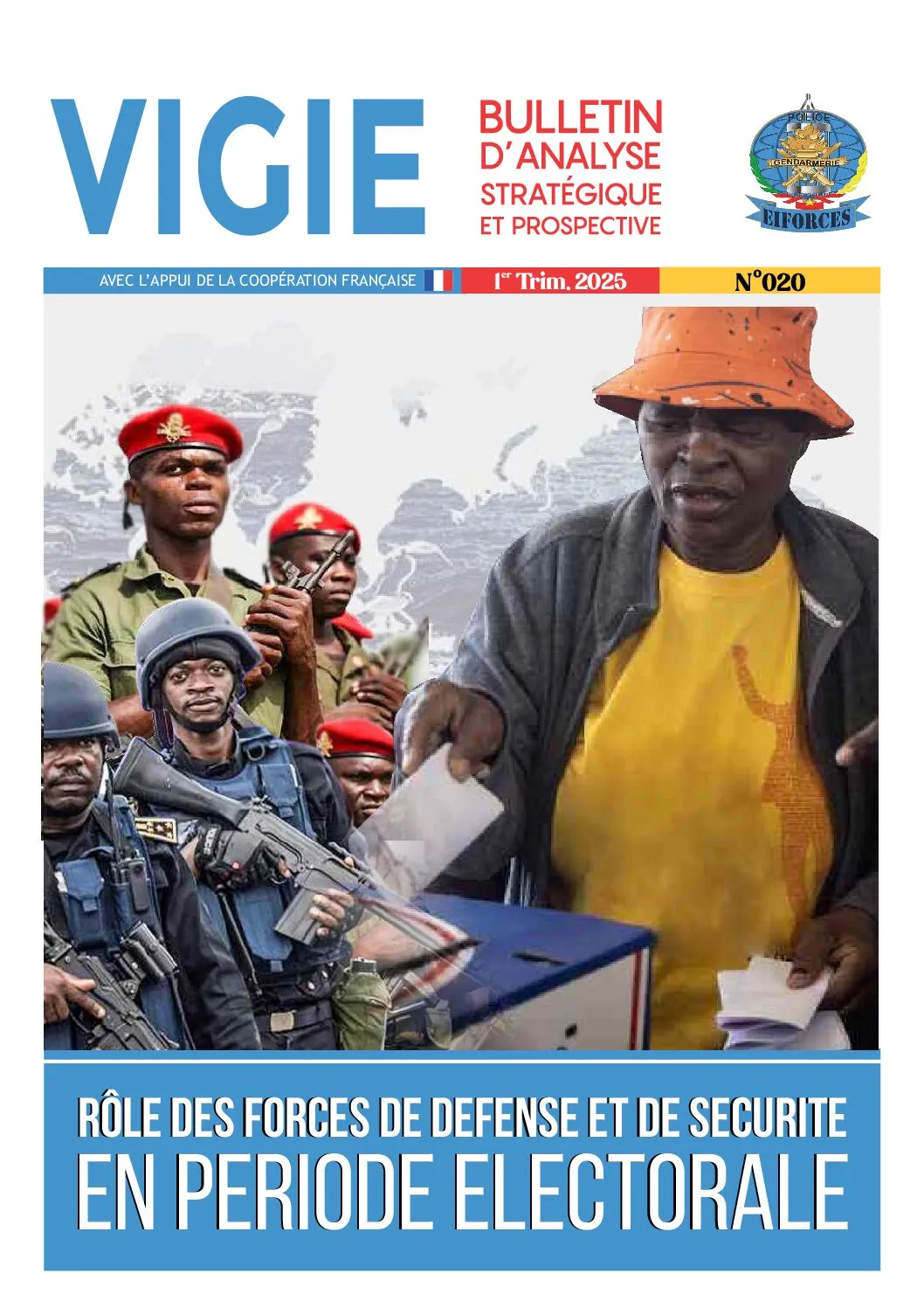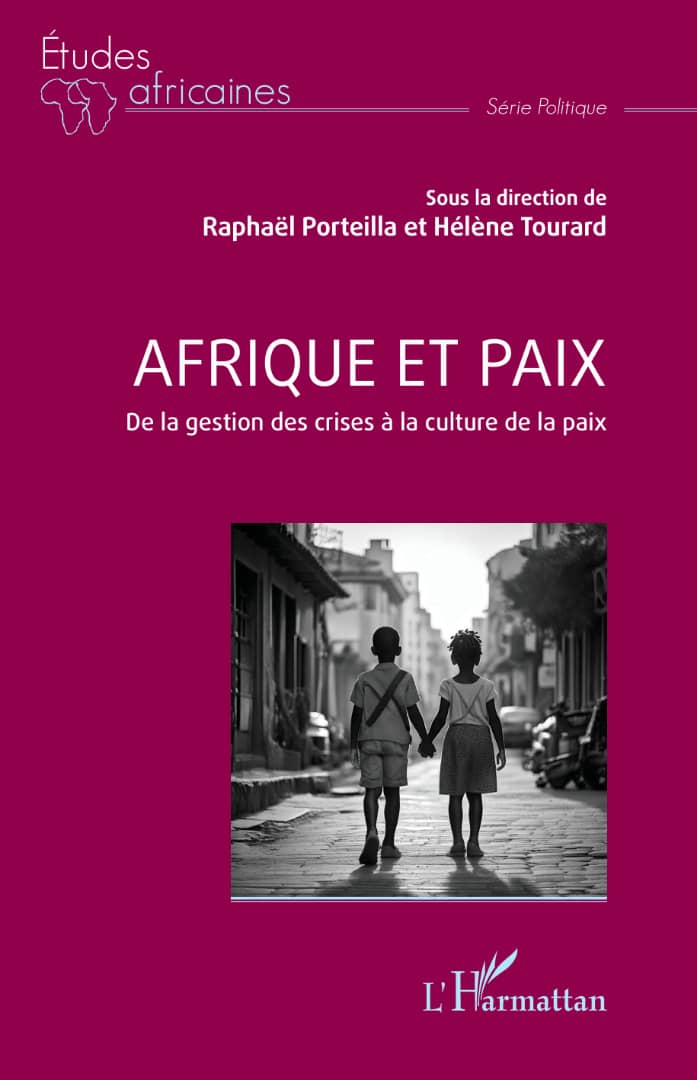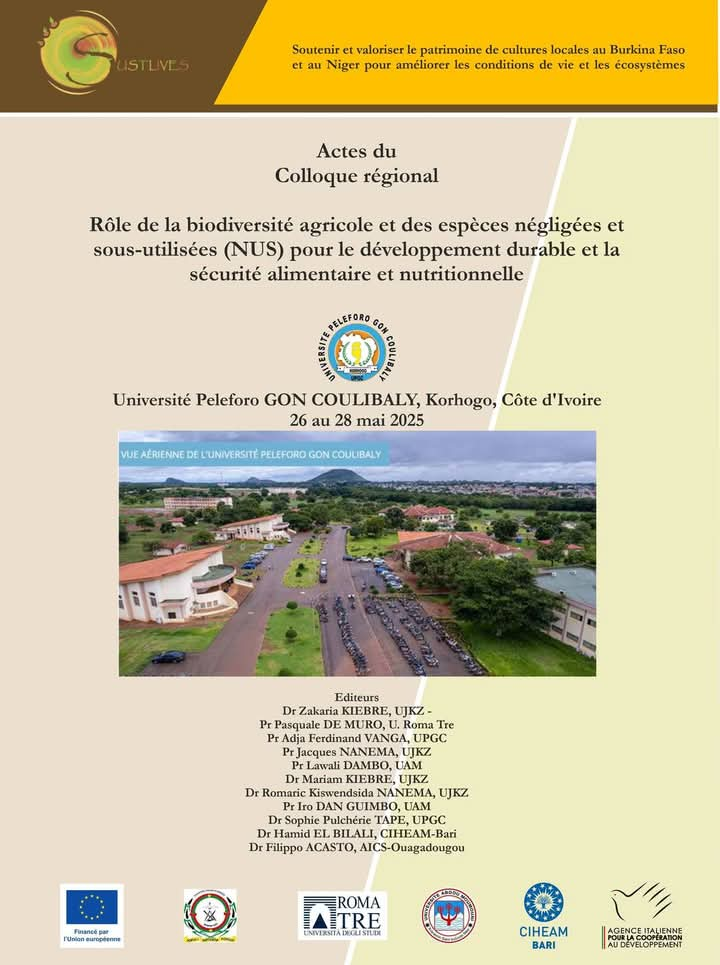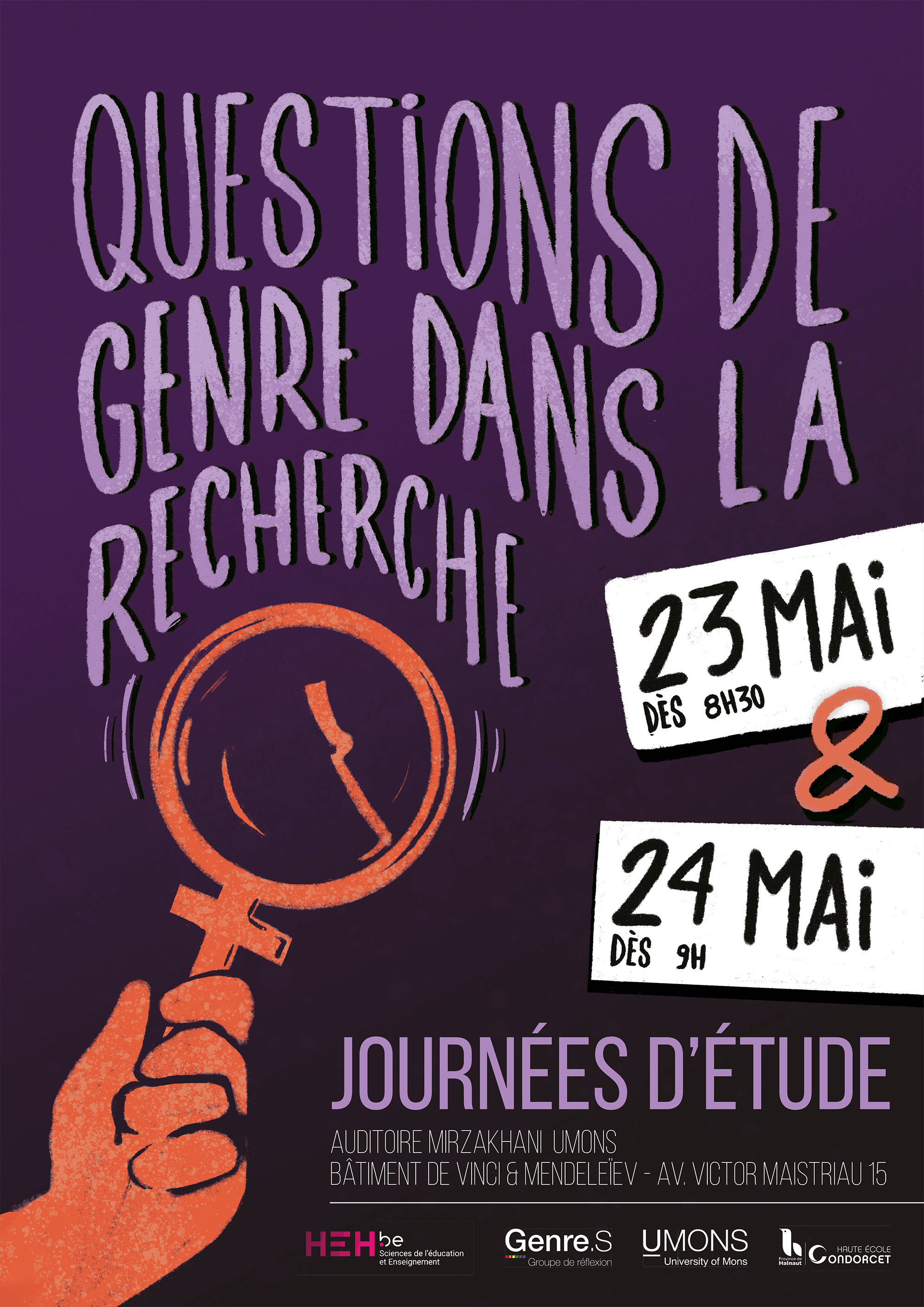Le Conseil Ouest et Centre Africain pour la Recherche et le Développement Agricoles (CORAF) en collaboration avec le Conseil pour la Recherche Scientifique et Industrielle (CSIR) a organisé la troisième édition du symposium sur la recherche agricole du 19 au 21 novembre 2024 à Accra, au Ghana, sous le thème : « Agriculture et Durabilité Environnementale : la voie de la transformation des systèmes agroalimentaires en Afrique de l’Ouest et du Centre ». Cet évènement a ressemblé des experts et chercheurs, des décideurs politiques, des partenaires internationaux, des représentants du secteur privé, et des acteurs de la recherche, avec pour objectif spécifique de promouvoir les travaux de recherche sur les pratiques agricoles durables et résilientes face aux défis du changement climatique et de la dégradation des ressources naturelles.
Le CRIC a pris part à ce Symposium à travers son Directeur exécutif, Dr. Metsagho Mekontcho Boris et Yemo Ngouegni Yoganie, Chercheure au sein de l’Institute for Local Knowledge (ILK) du CRIC et par ailleurs Doctorante en Biotechnologie Végétales à l’Université de Dschang au Cameroun.
1-Metsagho Mekontcho Boris a présenté une communication orale intitulée : « Intégrer les savoirs locaux : un levier pour la préservation et la restauration de la fertilité des sols dans l’arrondissement de Babadjou (région de l’Ouest-Cameroun) », s’inscrivant dans l’axe 3 du symposium : « Fertilisants et santé des sols : pratiques durables pour le recyclage des nutriments et la sensibilisation à la santé des sols ». Cette communication s’inscrit dans le cadre des réflexions en cours au sein de l’Institute for Local Knowledge (ILK) du CRIC, qui a pour objectif de contribuer à la documentation, la capitalisation, la vulgarisation et la conservation des savoirs locaux à long terme au Cameroun en vue de leur promotion dans le développement durable de nos sociétés et aux réponses alternatives aux défis sociétaux.

Dans sa communication, l’auteur fait remarquer que : « La “ mort ” de la fertilité des sols liée à la destruction du couvert végétal, des pratiques agricoles non durables, les impacts du changement climatique ont pour conséquence directe, la chute sensible et graduelle des productions agricoles entrainant la pauvreté au niveau des populations rurales. Face à cette mort des sols agricoles en faisant un recours excessif aux engrais et pesticides chimiques pour fertiliser leurs exploitations et lutter contre les ennemis des cultures (adventices, insectes, microbes…). Ce qui ne semble pas être une solution durable puisque le constat est clair : les productions diminuent graduellement d’une campagne à l’autre quoique les quantités d’intrants de synthèse appliqués tendent même à doubler. Il existe pourtant des solutions qui peuvent permettre d’inverser cette évolution : il s’agit des savoirs traditionnels de gestion de la fertilité des sols. Un large panel de ces savoirs s’apparente aux principes agroécologiques. D’une part les savoirs de maintien de la fertilité des sols : le recours à la jachère – l’intégration de l’élevage à l’agriculture – l’enfouissement des matières organiques sous les billons – le recyclage de la biomasse – la pratique de l’écobuage – la rotation de culture – etc. D’autre part les savoirs localisés de lutte antiérosive : l’association de plusieurs cultures sur le même billon – l’association des arbres aux cultures – la couverture du sol à travers par exemple le maintien des résidus de récoltes sur les champs – agroforesterie traditionnelle – les cultures intercalaires – le bocage bamiléké qui a montré son efficacité aussi bien dans le marquage de l’espace que dans la préservation des sols contre l’érosion et la conservation de la biodiversité ».
L’auteur révèle toutefois que ces savoirs endogènes ont été progressivement délaissés au profit des pratiques culturales peu respectueuses de la santé des sols et de la préservation de l’environnement. Au rang des facteurs d’abandon de ces savoirs agroécologiques ancestraux, le chercheur relève les éléments suivants :
(i)– l’introduction de la “ modernisation agricole ”, et l’usage des intrants de synthèse, ont profondément transformé le rapport des paysans au savoir, les amenant à mobiliser plus de techniques et de technologies développées à l’extérieur de leur champ, au détriment de leurs propres capacités d’agir.
(ii) La “faim de terres” liée à la forte pression démographique, a entraîné une densification de l’espace, l’abandon progressif de la jachère et d’autres savoirs comme le bocage traditionnel.
(iii) le manque d’innovations et la base agroécologique de la pratique et la faible transmission des savoirs traditionnels ont rendu la pratique agricole plus conventionnelle au détriment des savoirs localisés.
(iv) le poids d’un discours dominant chez les cultivateurs selon lequel, le Cameroun ne peut pas se nourrir sans l’utilisation de produits agrochimiques et d’une évolution de l’agriculture. Ce discours cultive une réticence à l’adoption des pratiques agroécologiques.
(v) L’absence d’une conscience collective sur la nécessité de préserver la santé des sols, etc.
(vi) La réticence des populations à adopter les pratiques agroécologiques en raison du manque de connaissances.
Il est ressorti de cette communication que : « les savoirs agricoles localisés des paysans de Babadjou ont jadis joué et peuvent jouer encore un rôle déterminant dans le maintien de la fertilité des sols. Ces savoirs délaissés représentent pourtant des ressources locales potentiellement activables pour stimuler des formes d’innovation en agriculture et soutenir la mise en place d’un système agroécologique. Dans un contexte de recherche des bonnes pratiques agricoles pour restaurer la fertilité des sols et renforcer la résilience aux effets du changement climatique, les savoirs locaux sont à restaurer et à adapter aux réalités actuelles ». Le chercheur appelle à une revalorisation des savoirs locaux de fertilisation des sols agricoles afin de développer une agriculture respectueuse de l’environnement, des lois de la vie du sol et capable de produire une alimentation à haute valeur nutritive.
2-Yemo Ngouegni Yoganie a présenté les résultats d’une recherche expérimentale sur la production des semences améliorées de pommes de terre intitulé : « La technologie des “boutures apicales racinées (BAR) ” : une solution d’atténuation du stress biotiques et abiotiques dans la production des semences améliorées de pommes de terre ». Ce thème s’inscrivait dans l’axe thématique du symposium : « Changement climatique/agroécologie : stratégies d’atténuation des stress biotiques et abiotiques en agriculture ». Cette recherche a été réalisée au sein de l’entreprise agricole Agrobiotech Farm dans la région de l’Ouest Cameroun, qui concentre à elle seule plus de la moitié de la production nationale.

La chercheure a rappelé que « dans un contexte où la pomme de terre est une culture importante pour la sécurité alimentaire et le développement économique du Cameroun, elle contribue à la subsistance des populations rurales et urbaines. Malgré cette importance, le rendement moyen de la pomme de terre au Cameroun est estimé à 9 t/ha ; ce qui est de loin faible au rendement potentiel de 25 t/ha enregistré dans les stations de recherches. Les principales causes de cette faible production sont l’accès difficile aux semences de qualité et l’utilisation des semences traditionnelles issues de la multiplication végétative des tubercules souvent infectées par les maladies et les ravageurs.
Afin d’inverser cette tendance, la chercheure rappelle que le gouvernement camerounais à travers l’Institut de Recherche Agricole pour le Développement (IRAD) en collaboration avec le Centre International de la Pomme de Terre (CIP), a proposé plusieurs variétés à haut rendement, lesquelles ont été largement adopté par les producteurs. Toutefois avec la pression environnementale liée au changement climatique, ces variétés ont perdu leurs performances et sont devenues susceptibles aux ravageurs et maladies.
Face à ce constat, le moyen le plus efficace pour accroitre la productivité de cette culture est la vulgarisation de la technologie de multiplication des semences par la technique de Boutures Apicales Enracinées (BAR) à partir des vitro-plants. Les boutures apicales racinées sont des transplants produits dans une serre à partir de vitro plants qui sont maintenus à l’état juvénile. Par conséquent, ces boutures ont un potentiel de rendement plus élevé ; ce qui se traduit par une plus grande valeur marchande.
Les résultats présentés par la chercheure montrent que la technologie des boutures apicales enracinées permet de produire les semences de pommes de terre en qualité et en quantité et en peu de temps. Elle conclût avec force que : « la vulgarisation rapide de la technologie des boutures apicales enracinées pourrait permettre d’augmenter voire doubler les rendements de pommes de terre en Afrique et particulièrement au Cameroun pour franchir le seuil des 900 000 tonnes/ha à l’horizon 2030 comme le souhaite ce dernier. Toutefois, un réel défi reste à relever à savoir : l’insuffisance des laboratoires de Biotechnologie à même de produire les vitro plants en quantité, le manque des activités de sensibilisation des producteurs par rapport à cette technologie. Il faudrait former les producteurs de semences de pommes de terre à la technologie des BAR et distribuer des vitro plants aux producteurs de semences de ce tubercule ».
Cette communication a été retenue parmi les 13 meilleures présentations remarquables, en termes de contribution à l’innovation et la durabilité environnementale. Pour rappel, ce symposium a enregistré 93 communications, dont 35 en ligne, 19 affiches et 39 en personne.