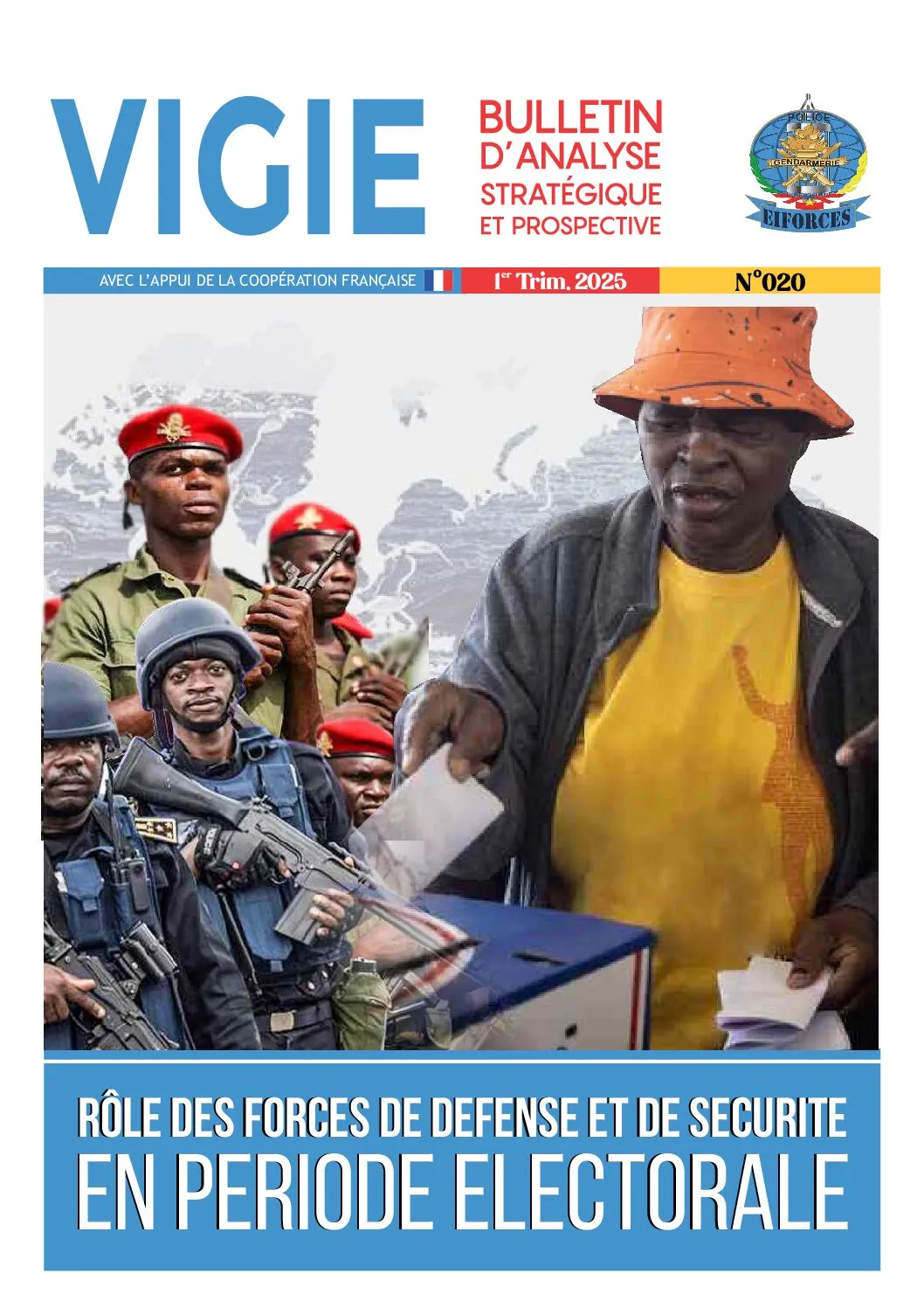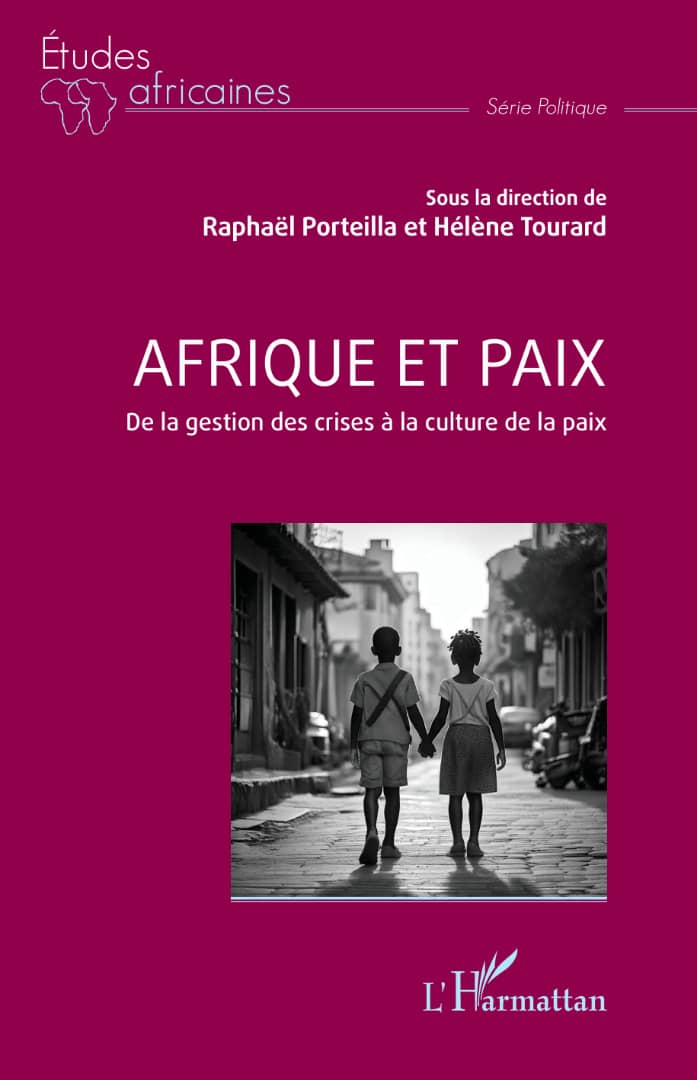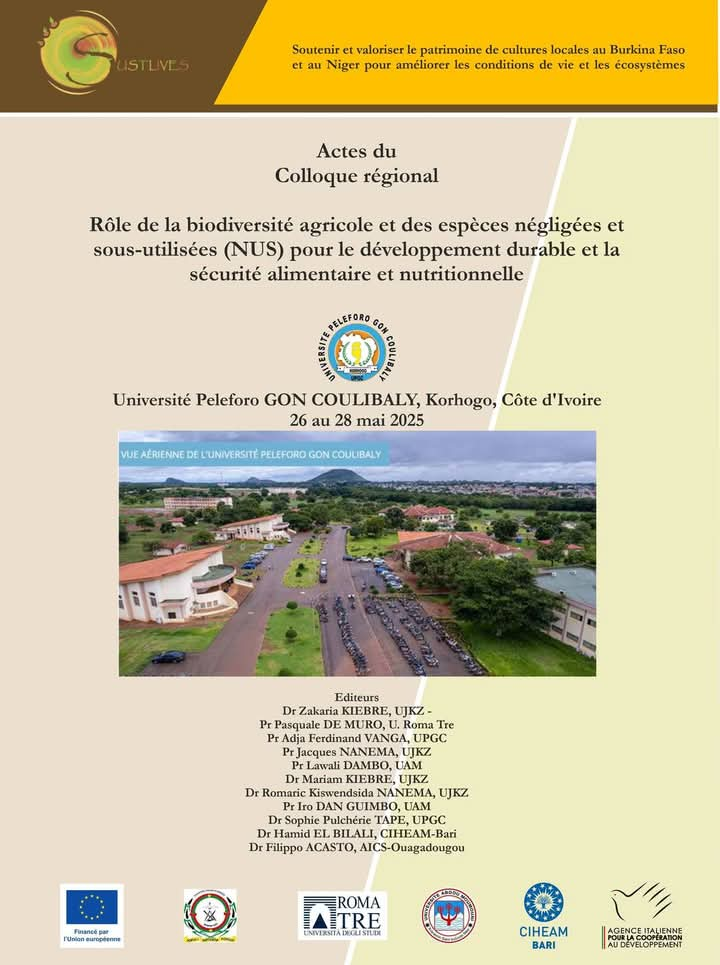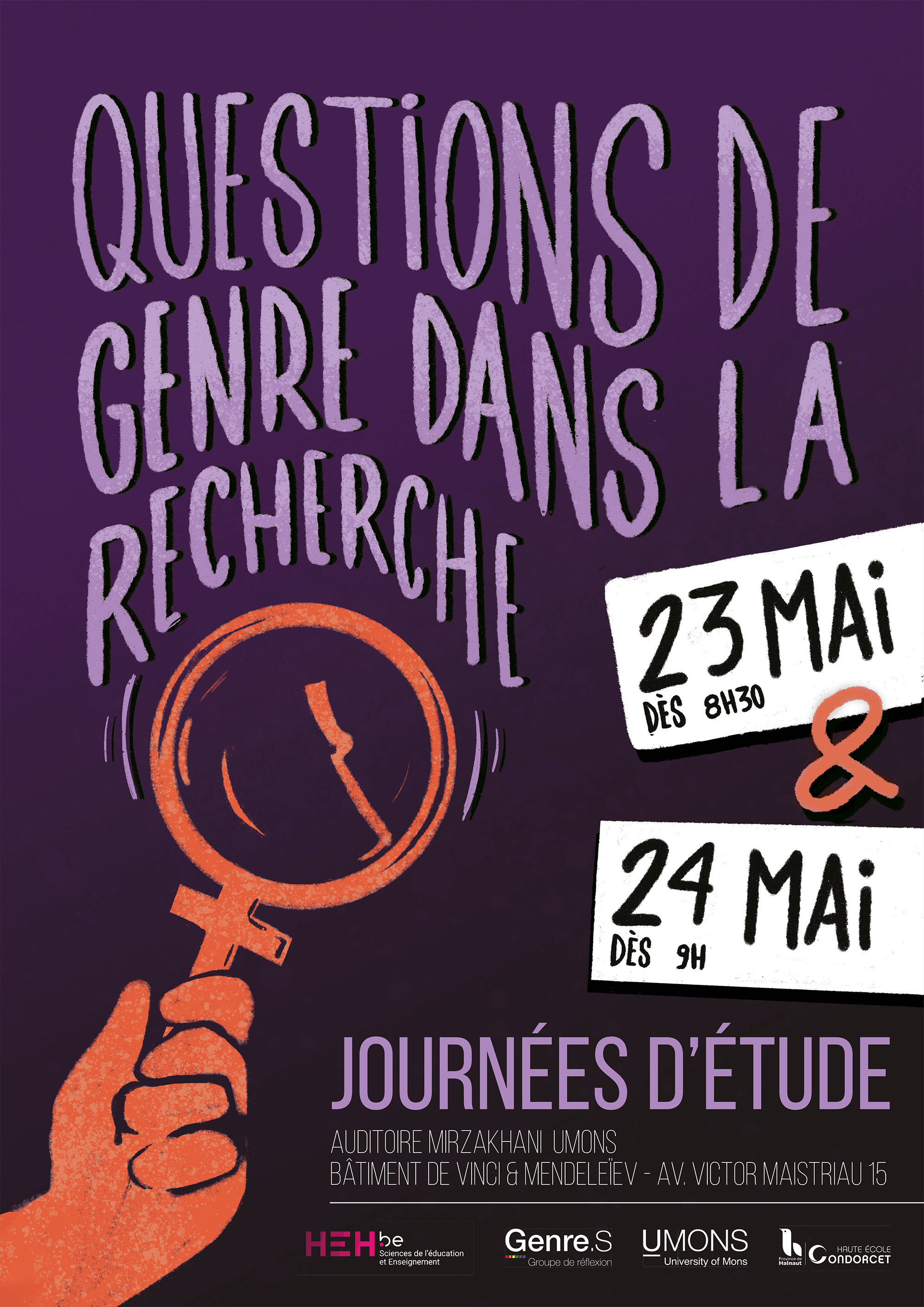Hurbrech Jeff Obiang Tenezeu, doctorant en science politique à l’Université Lumière Lyon 2/Triangle et chercheur de l’Institute for Participation and Democracy (IPD) du CRIC, a participé au Colloque international « De l’ “Afrique en miniature” au “Continent” ? Cameroun 2025 », tenu à l’Université Bordeaux-Montaigne du 21 au 22 mai 2025.
Sa communication a porté sur : « Comprendre les logiques de l’abstention aux élections présidentielles et législatives camerounaise depuis l’avènement de la démocratie pluraliste ». (Voir le programme : ici).
Communication : « Comprendre les logiques de l’abstention aux élections présidentielles et législatives camerounaise depuis l’avènement de la démocratie pluraliste »
Par: Jeff Hurbrech Obiang Tenezeu




Contexte
L’auteur part de deux images ci-dessous qui sont illustratives de la situation du Cameroun et permettant dans une certaine mesure de situer le sujet dans son contexte, en montrant comment d’une part l’instauration de la démocratie a permis d’organiser les élections pluralistes au Cameroun (image 2 ; Biya l’homme du progrès et des grandes ambitions) et dans le même temps ces élections n’ont pas « toujours » pour finalité de désigner les véritables détenteurs du pouvoir (image 1 ; Biya, l’immortel au pouvoir).
Image 1 : Post d’un blogueur
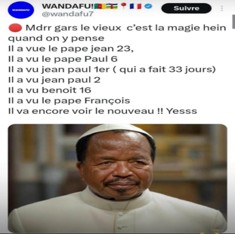
Image 2 : Photo de Paul Biya
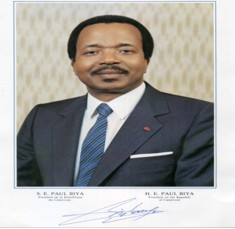
Source : capture d’écran à partir du compte X de l’auteur
Le processus de démocratisation engagé dans la plupart des pays d’Afrique subsaharienne à la fin de la fin des années 80 a insufflé une nouvelle dynamique permettant d’organiser des élections. Cette période marque ainsi la fin du monopole partisan qui se manifestait dans la dynamique électorale par des « élections sans choix ».
Au Cameroun, ce processus a été accueilli avec enthousiasme au point de susciter l’espoir des citoyens-électeurs à travers de leur forte mobilisation aux élections de la « première génération ». Mais la particularité avec ces élections est qu’elles se déroulent dans un environnement d’un système qui semble ne pas s’être totalement débarrassé de son passé autoritaire. Cette emprise autoritaire aura donc tendance à pervertir les élections en les détournant de leurs fonctions premières, permettant de remettre en cause les fondements et la légitimité du pouvoir en place (conservatisme, l’immobilisme électoral).
Tableau 1- : Evolution de l’abstention aux élections présidentielles de 1992 à 2018 au Cameroun
| Élection | Candidat | Parti politique | Suffrages obtenus | Taux d’abstention |
| 1992 | Paul Biya | RDPC | 39,98% | 28,1% |
| 1997 | Paul Biya | RDPC | 92,57% | 16,9% |
| 2004 | Paul Biya | RDPC | 70,92% | 17,77% |
| 2011 | Paul Biya | RDPC | 77,99% | 31,72% |
| 2018 | Paul Biya | RDPC | 71,28% | 46,15% |
Source : tableau conçu par l’auteur à partir d’un assemblage des données
L’auteur fait remarquer qu’en pratique, les élections organisées depuis l’entame du processus démocratique au Cameroun ont été pour la plupart émaillées de fraudes, suscitant ainsi des contestations qui engendrent le plus souvent la remise en cause des élus. Ce contexte permet de comprendre en amont l’environnement dans lequel se déroulent les élections.
En plus de ce contexte de manipulation électorale et de contestation des résultats du scrutin, les élections camerounaises, un peu comme dans la plupart des systèmes démocratiques, s’inscrivent dans une dynamique de démobilisation politique. Cette dynamique de baisse de la participation révèle donc un accroissement des citoyens qui ne votent pas alors qu’ils seraient en âge de le faire.
Tableau 2 : Evolution de la population totale, population électorale théorique, inscrits, non- inscrits, votants et non-votants aux élections présidentielles depuis 1992
| Année | 1992 | 1997 | 2004 | 2011 | 2018 |
| Population totale | 12 391 000 | 13 941 181 | 16 809 407 | 20 138 637 | 24 836 674 |
| Population électorale | // | // | // | 9 185 958 | 13 886 986 |
| Inscrits | 4 195 687 | 4 220 136 | 4 657 748 | 7 251 651 | 6 667 754 |
| Non-inscrits | // | // | // | 1 934 307 | 7 219 232 |
| Votants | 3 015 448 | 3 506 945 | 3 830 272 | 4 951 434 | 3 590 681 |
| Taux de participation | 71,9 % | 83,10 % | 82,23 % | 68,28 % | 53,85 % |
| Taux d’abstention | 28,1 % | 16,9 % | 17,77 % | 31,72 % | 46,15 % |
Source : tableau conçu par l’auteur à partir d’un assemblage des données
Tableau 3 : Evolution de l’abstention et de la participation aux élections législatives au Cameroun depuis 1992
| Années | 1992 | 1997 | 2002 | 2007 | 2013 | 2020 |
| Taux d’abstention | 39,41 % | 75,67 % | 36,66 % | 32 % | 23,22 % | 56,21 % |
| Taux de participation | 60,59 % | 24,33 % | 63,34 % | 68 % | 76,78 % | 43,79 % |
Source : tableau conçu par l’auteur à partir d’un assemblage des données
Le basculement dans un cycle de baisse de la participation affecte donc les élections présidentielles et législatives camerounaises depuis le retour au multipartisme. À partir de ces constats, Jeff Hurbrech Obiang Tenezeu s’est proposé d’examiner les ressorts de ce phénomène de baisse de la participation électorale. La question de recherche à laquelle il a tenté de répondre est la suivante : Pourquoi les électeurs camerounais décident-ils le jour du vote de se mettre en marge du scrutin ?
Approches théorique et méthodologique
Pour tenter de répondre à cette question, Jeff Hurbrech Obiang Tenezeu a mis en parallèle une approche qualitative avec les entretiens semi-directifs (environ une cinquantaine réalisée dans la ville de Douala) à une revue de la littérature basée sur la sociologie électorale.
Il fait remarquer que l’abstention est l’une des premières données mobilisées lors des élections. Cette donnée fait l’objet de plusieurs études dans la science politique internationale. Une bonne partie de la science politique occidentale en a fait d’elle son centre d’intérêt au regard de l’abondante littérature sur la question. En revanche, la littérature sur les comportements électoraux reste significativement faible par rapport à la complexité des phénomènes électoraux. La sociologie électorale africaine en général serait donc le parent pauvre de la science politique internationale. Les études existantes, beaucoup plus aériennes, se bornent à saisir le phénomène abstentionniste à partir de certaines pratiques électoraux (mal-inscrits, doublons, personnes décédées non radiées…)
À la différence de ces études plus ou moins aériennes axées sur l’analyse des pratiques de l’abstention, la communication du chercheur a essayé de questionner les enjeux autour des taux d’abstention plus ou moins élevés au Cameroun en allant interroger les personnes qui les ont produits. Elle envisage donc avoir un ancrage empirique important qui permet de dégager les facteurs explicatifs du non-vote.
Sur l’enquête proprement dite, l’auteur a centré le regard sur le Cameroun comme unité de recherche. Ne pouvant cerner la question à traiter sur tout le pays, il a circonscrit l’étude au niveau de la ville Douala. Deux principales raisons ont justifié ce choix : à partir des flux migratoires observés dans le pays, Douala se lit à la fois comme une ville cosmopolite (carrefour du Cameroun) où l’on retrouve pratiquement tous les segments de la société camerounaise et certaines dynamiques protestataires (signe de la vitalité démocratique des citoyens).
Sur le plan purement politique, il s’agit d’une ville touchée par la précarité et où les contrastes riches/pauvres sont très marqués. C’est donc cet environnement social et économique précaire qu’on rencontre aussi les citoyens parfois hostiles à la politique et aux élus qui font un usage détourné du vote.
Le type de scrutin retenu se justifie quant à lui à la fois par leur ordre d’importance ou de grandeur (deux élections aux suffrages universels directs), mais aussi et surtout par l’ampleur du phénomène abstentionniste à ces types d’élections au cours de ces dernières années.
Résultats obtenus
À partir des entretiens recueillis, il en ressort que l’abstention au Cameroun est un phénomène complexe et multicausal. Les résultats montrent qu’il est à la fois :
1-La manifestation d’une prise de distance des électeurs à l’égard d’un processus électoral qu’ils jugent imparfait et taillé à la mesure de ceux qui gouvernent (ou du parti au pouvoir.) Ceci se manifeste à travers :
-Les perceptions négatives que les électeurs camerounais se font des élections, notamment de la procédure de désignation des gouvernants.
-La défiance de plus en plus grande qu’ils développent envers les institutions et/ou les agents électoraux qui, selon eux, se distinguent par une emprise du système qui semble selon eux ne pas faciliter leur autonomie décisionnelle en termes de gestion des élections.
-L’abstention des électeurs camerounais est aussi un signe d’indifférence par rapport aux institutions représentatives (partis politiques) qui, pour la plupart d’entre eux, ne sont pas suffisamment proches de leurs préoccupations quotidiennes.
2-L’environnement sociopolitique précaire dans lequel évoluent les électeurs camerounais constitue aussi, pour une majeure partie d’entre eux, le signe de leur désinvestissement de la scène électorale. À ce niveau, on observe comment la précarité favorise l’exclusion sociale et politique. Ce lien entre précarité et retrait de la scène électorale se lit à travers :
-Le retrait de la vie sociale et politique du fait de la carence des services publics de base (l’eau, électricité, routes…) et/ou des inégalités sociales (redistribution imparfaite des ressources publiques ?).
-Le mouvement de rejet que les électeurs développent de plus en plus envers la classe politique dans sa « façon de faire et d’agir » (la posture des élites politiques face au diagnostic social précaire posé par les électeurs interrogés).
-Une forme d’hostilité des électeurs à l’égard des choix des politiques publiques mises en œuvre ou pas par les gouvernants.