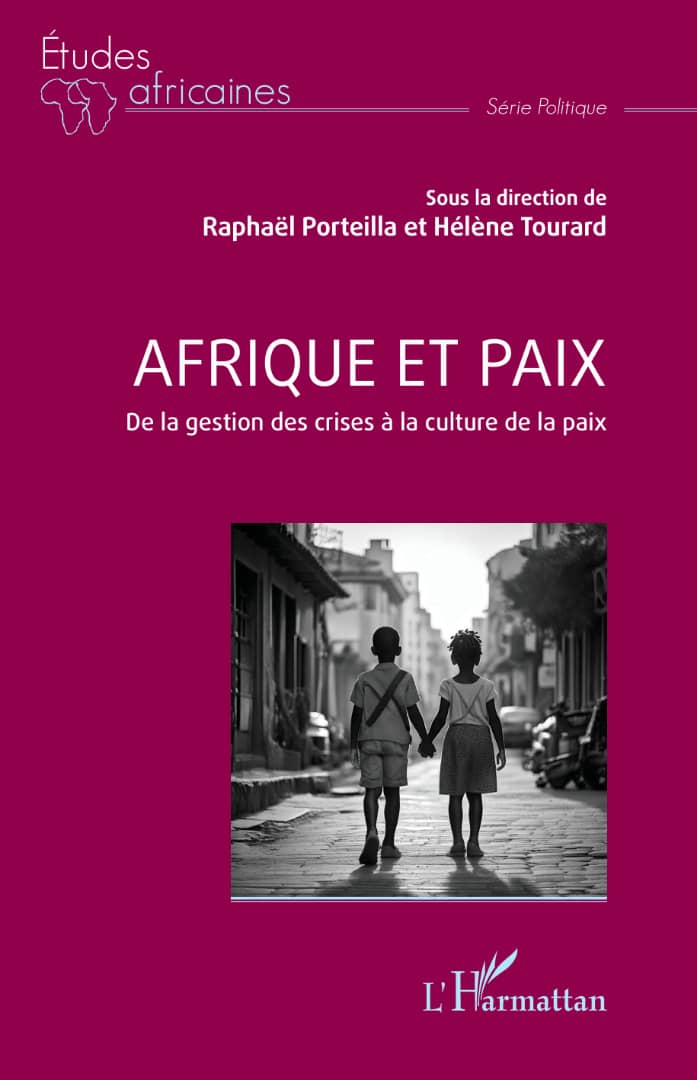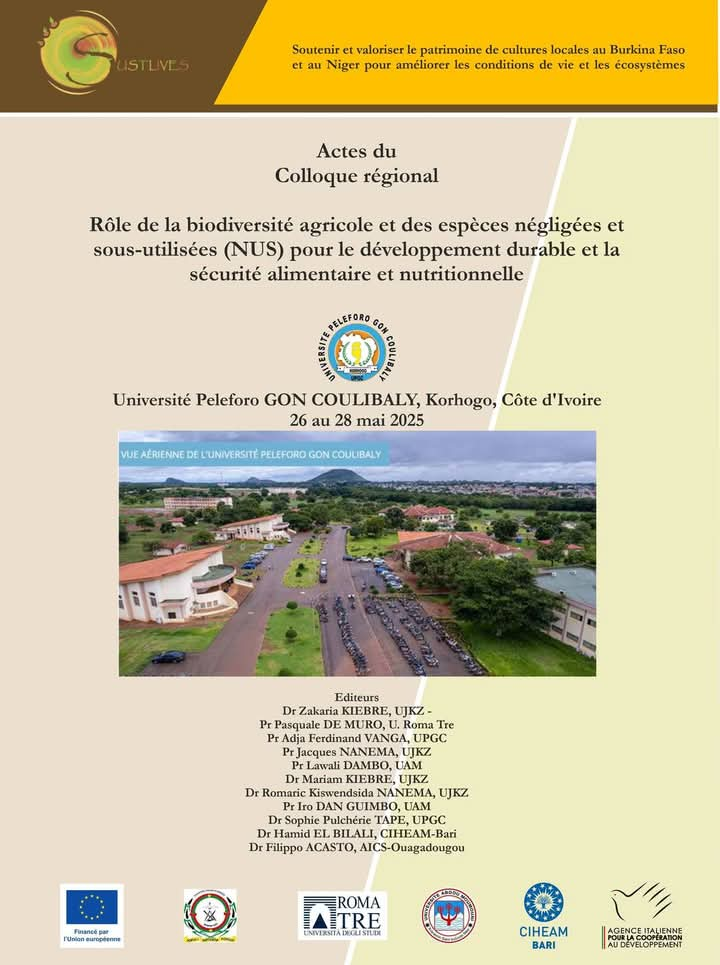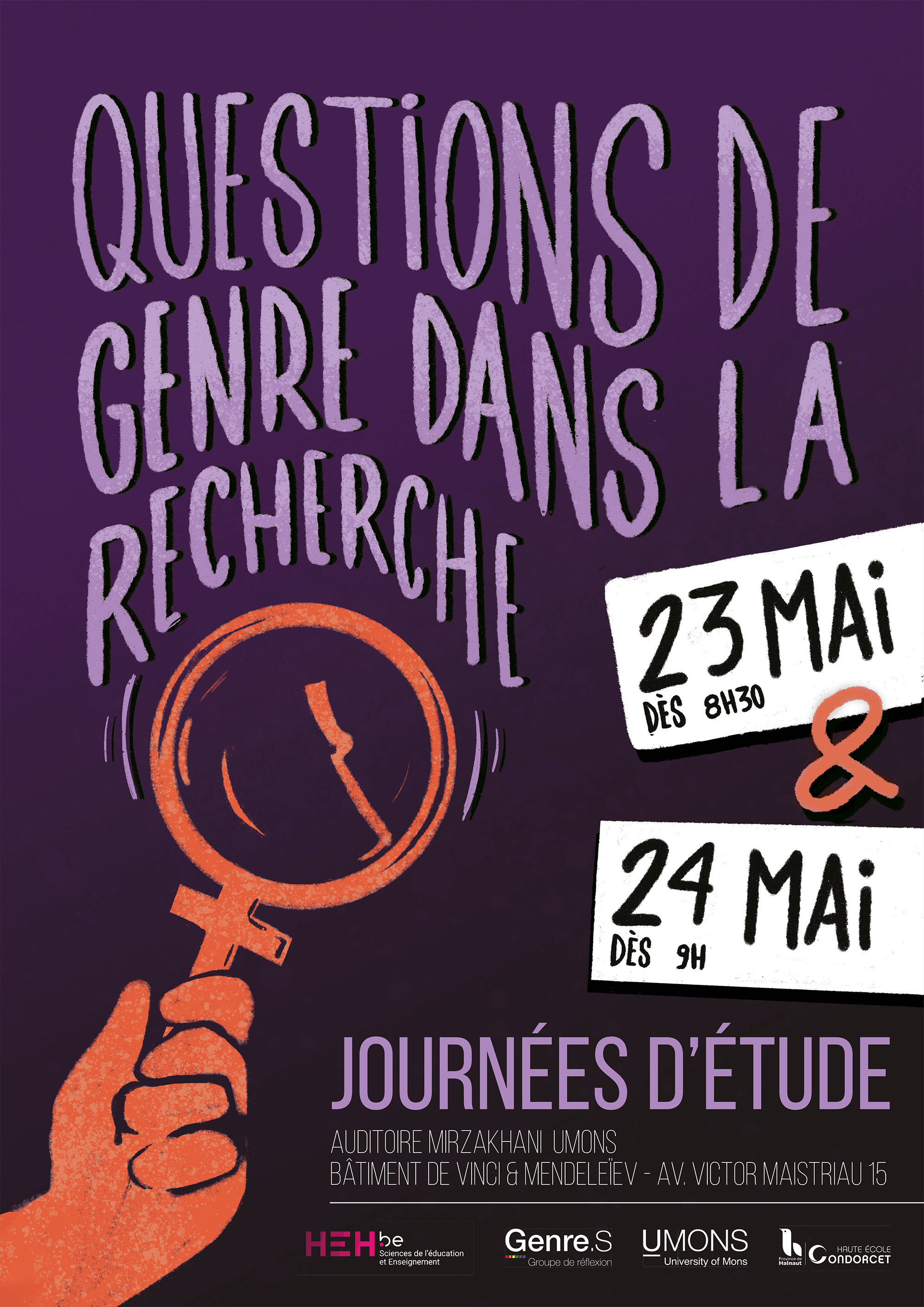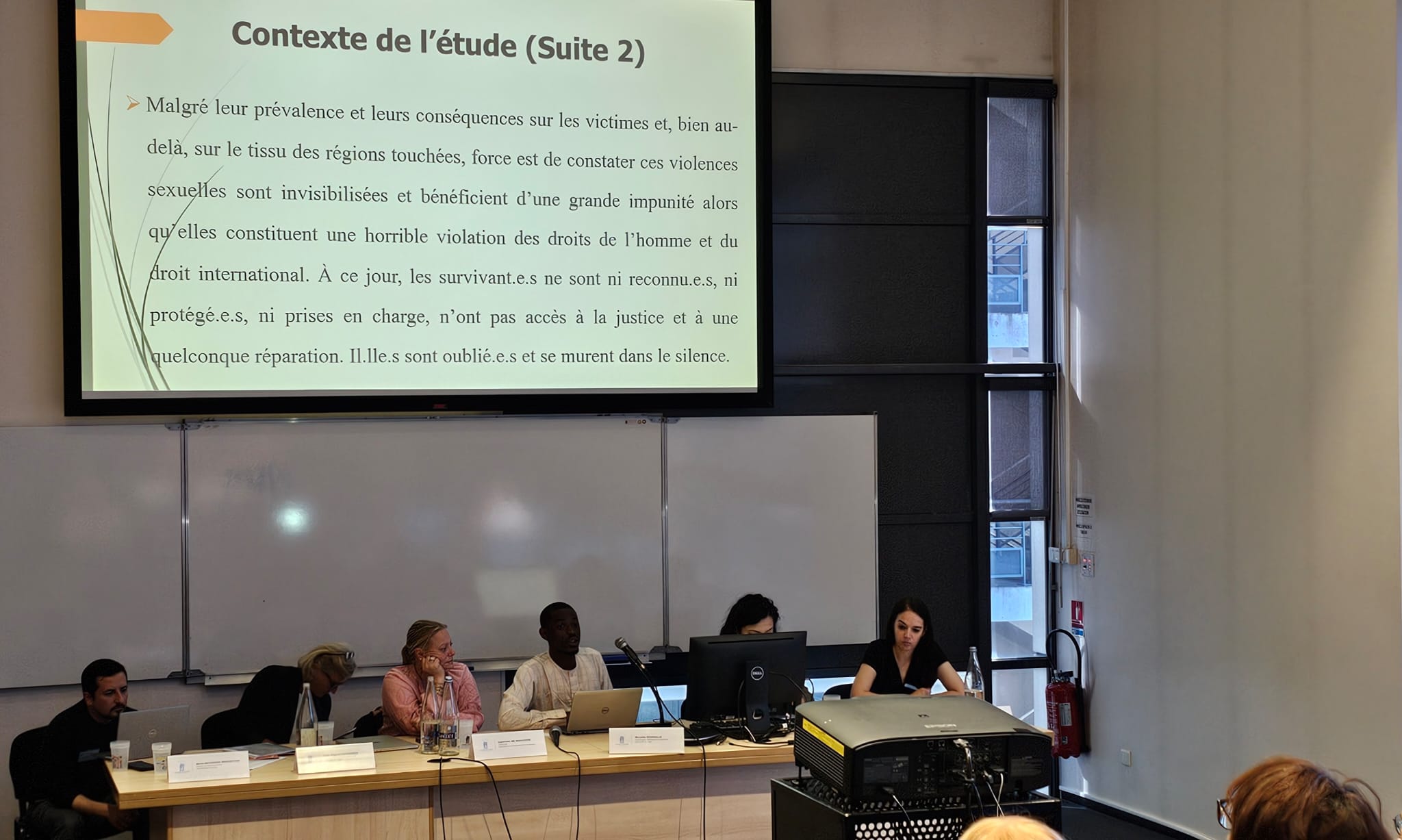1-Mise en contexte du projet
Vingt ans après le 11 septembre 2001, le monde continue de connaître des soubresauts majeurs et de profondes recompositions de puissances. L’ordre international mis en place peu après la Seconde Guerre mondiale est remis en cause (Delamotte et Tellenne, 2021). La dislocation du bloc soviétique marquant la fin de la guerre froide et naturellement la fin d’un monde bipolaire longtemps structuré autour d’une rivalité Ouest/Est a engendré de nombreux changements au sein de l’arène internationale. La mutation majeure est « l’instabilité fondamentale du monde, la fragmentation des espaces stratégiques ». « Jamais on n’a décompté autant de puissances pouvant, dans leur espace de jeu, dérégler les équilibres internationaux ; jamais les puissances dominantes n’ont semblé aussi impuissantes à parer à la fragmentation du monde » (Montbrial et David, 2025, p.17).
Cette fragmentation est marquée par l’irruption dans le système international de nouveaux acteurs appelés émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine, Turquie, Afrique du Sud, Qatar, Arabie Saoudite etc.), qui s’imposent comme les moteurs de ce nouveau millénaire et tentent de réformer l’ordre international libéral et font figure de gagnantes de la mondialisation (Santander, 2012 ; Deschaux et al., 2017, Badie et Vidal, 2012). L’Occident dans sa diversité est désormais sur la défensive face à la montée des pays du Sud. Ceux-ci, poussés par la Russie et la Chine, semblent bousculer l’ordre issu de l’après-1945. Le monde assiste à l’affirmation d’un « Sud global » aux contours imprécis, fondé sur l’idée proprement géopolitique selon laquelle le cycle de l’« Occident collectif » – ouvert avec l’expansion européenne des Temps modernes, et dont l’apogée, après la « guerre civile européenne » (Noltke), a coïncidé avec l’hégémonie des États-Unis dans le cadre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) – est en train de se refermer (Montbrial et David, 2025).
Dans ce contexte mondial marqué par la remise en cause de la mondialisation, l’affaiblissement de la coopération internationale et l’émergence de nouvelles puissances, l’Afrique, le « Dark continent» que l’on qualifiait de « perdu de la mondialisation » ou comme une « cause perdue » de l’économie internationale (Santander, 2016), occupe une place stratégique et suscite un intérêt particulier. Elle attire et séduit les différentes puissances (traditionnelles et émergentes) et redevient au centre de la géopolitique mondiale au regard de son poids démographique, géopolitique et économique. À vrai dire, l’Afrique est (re)devenue le nouvel enjeu mondial, un objet de convoitises et un terrain de rivalités pour les puissances industrielles traditionnelles (Europe, Etats-Unis) toute une série d’acteurs émergents (Brésil, Chine, Russie, Inde, etc.), nouvelle voie d’accès aux ressources rares non renouvelables, à la diversification des sources d’approvisionnement et aux tractations inter-étatiques et autres jeux d’alliances qu’impliquent la coopération et les négociations au sein des organisations internationales.
L’Afrique bien que minée par de nombreux maux, fait aujourd’hui partie intégrante de la politique étrangère des puissances ascendantes dans un contexte de « décompression hégémonique » (Hurrell, 2006). Par des initiatives variées, multisectorielles, bilatérales et/ou multilatérales, ces émergents affirment leur volonté de s’installer définitivement sur le continent. L’Empire du milieu poursuit la consolidation de sa coopération avec l’Afrique. En moins de deux décennies, il est devenu son premier partenaire économique. Il s’est engagée à investir 1000 milliards de dollars en infrastructure d’ici 2049. Plus de la moitié des investissements prévus par le pays dans le cadre de cette « nouvelle route de la soie » est destinée à l’Afrique. De plus, l’Afrique est de plus en plus courtisée par la Russie, en quête de redéfinition d’une influence internationale et adoptant une logique de conquête d’un strapontin dans un continent inondé par des milliers de milliards de réserves chinoises. D’autres émergents classiques comme l’Inde, le Japon, les pays émergents de l’Amérique Latine et les puissances moyen-orientales (respectivement la Turquie, Israël, l’Arabie saoudite, le Qatar, les Émirats arabes unis (EAU) et l’Iran) sont aussi attirés par le continent africain. Ces dernières années, la Russie a sans doute accru son influence en Afrique plus que tout autre acteur extérieur. Ces engagements s’étendent du renforcement des liens en Afrique du Nord à l’extension de son influence en République centrafricaine et au Sahel, en passant par le renouveau des liens de la Guerre froide en Afrique Australe (Africa Center for Strategic Studies, 2025).
De cette coopération Sud-Sud axée sur la volonté de gains mutuels, de respect de la souveraineté se pérennisent sous nos yeux les nouvelles relations internationales. Partant, dans leur quête, ces puissances dont certaines sont en recomposition étalent savamment leur hard power et soft power. Désormais, les émergents et l’Afrique sont au cœur des grands (des)équilibres mondiaux. Inéluctablement, ils changent la face de l’échiquier mondial (Jaffrelot, 2008). Ce retour en fanfare des émergents sur le continent s’apparente à une énième opportunité de développement pour les dirigeants africains. Ces derniers doivent faire valoir leurs priorités, saisir les opportunités et rester vigilant pour faire face aux risques et éviter les répétitions des erreurs du passé que certaines coopérations peuvent induire. Par ailleurs, ces dernières années ont également marqué un tournant décisif dans les relations internationales africaines avec la remise en question des accords historiques et le démantèlement progressif des bases militaires étrangères sur le continent. Cette transformation s’accompagne d’une redéfinition majeure des relations avec les anciennes puissances coloniales, notamment illustrée par la dénonciation des accords monétaires traditionnels et la recherche de nouveaux modèle de coopération au développement.
Dans ce contexte de reconfiguration progressive et indéterminée de l’ordre international et des rapports de force en son sein, l’Afrique n’est plus un simple objet. L’Afrique, les pays et les différents acteurs africains sont de plus en plus des sujets qui s’insèrent dans les principaux enjeux internationaux où on assiste non seulement à une « fragmentation du monde »( Garcin, 2018) qu’en même temps à la réorganisation des puissances dans les relations internationales. La voix africaine est de plus en plus représentée dans la gouvernance mondiale. L’Union africaine a officiellement intégré le groupe des économies les plus puissantes du monde, le G20, alors que seule l’Afrique était jusqu’ici représentée, dont le sommet s’est tenu à New Delhi en Inde en septembre 2023. Toutefois, les experts s’interrogent sur la capacité de l’UA à parvenir à un consensus sur les priorités de la région, compte tenu de ses divisions internes. En outre, le 1er janvier 2024, les BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud), fondés en 2009 à l’initiative de la Russie, sont devenus les BRICS+. Six nouveaux pays – Arabie Saoudite, Argentine, Egypte, Emirats arabes unis, Éthiopie, Iran – ont intégré ce club de puissances émergentes prônant un nouvel équilibre des pouvoirs au sein du système international de la « gouvernance mondiale » – plus favorable aux intérêts du Sud. Au-delà de ces onze pays désormais réunis dans ce regroupement, une quarantaine d’autres, dont une vingtaine de manière appuyée ( du Bangladesh à l’Indonésie en passant par l’Algérie, la Bolivie, le Cuba, le Honduras, la Biélorussie, le Kazakhstan, la Turquie, la Tunisie, le Vietnam, le Nigéria, le Mexique, le Pakistan, le Sénégal, le Soudan et le Venezuela) ont également exprimé, à l’occasion de la tenue du XVe Sommet des BRICS de Johannesburg (23-24 août 2023), leur souhait d’un rapprochement ou d’une future adhésion (Ventura, 2023).
Le Président Donald Trump a opéré un retour historique dans l’histoire politique américaine en remportant les élections de novembre 2024 et en réintégrant la Maison Blanche en janvier 2025. Ce retour au pouvoir de Donald Trump à la Maison Blanche et le désintérêt progressif des États-Unis pour l’Afrique entrainent des recompositions géopolitiques sur l’ensemble du continent. Au-delà de la fin de l’USAID qui aura des répercussions sur la gestion de nombreuses crises, ce désintéressement, en réalité historique et traditionnel, favorise l’arrivée d’acteurs impatients d’occuper le siège laissé vacant. Ce retour de Donald Trump, autrement connu sous le nom de « Trump 2.0 » soulève également des questions sur l’évolution des relations afro-américaines et de leur impact sur les dynamiques partenariales du continent.
Bien que les nouvelles relations internationales soient construites majoritairement par des acteurs stato-centrés, on ne saurait occulter l’activisme et le rôle de plus en plus croissant d’acteurs privés, individuels et collectifs qui ont gagné en importance dans le système-monde. Les États ne sont plus les seuls acteurs à prétendre dominer le monde. Comme le relève Bertrand Badie : « Le système international se transforme, inévitablement, sans que les États n’en prennent la mesure : il intègre de nouveaux acteurs … » (Badie, 2018). Cette montée en puissance des acteurs non étatiques ou micro-unités dont les actions et interactions structurent et déstructurent le système international, est une tendance lourde, mise en lumière dès les années 1970 par le politologue américain James Rosenau : il évoquait des « changements structurels dans l’ordre géopolitique mondial, liés à l’intrusion d’acteurs privés, individuels et collectifs, réputés “hors souveraineté ”, relevant d’un processus de diffusion du pouvoir (power diffusion). La prolifération de ceux qui entreprennent des actions sur la scène internationale […] a accru l’interdépendance des peuples et des sociétés, au point de transnationaliser la structure de l’ensemble du système politique mondial » (Rosenau, 1979). Cette prolifération permet d’enrichir l’analyse des relations internationales en allant au-delà de simples relations interétatiques, et de montrer des logiques d’« interdépendance complexe » (Keohane and Nye, 1977), de réaliser un traitement plus « social » des relations internationales (Badie, 2016).
2-Objectif du projet
Ce projet de recherche a pour objectif de jeter un regard critique sur les nouvelles relations internationales avec un focus sur l’Afrique. Selon une approche critique et pluridisciplinaire, les différentes analyses permettront d’avoir des clefs de compréhension et interpretation de la complexité des mutations qui s’opèrent dans le système monde du 21e siècle.
3-Impact attendu
L’impact scientifique de ce projet se fera sentir à travers sa contribution à l’avancement des connaissances sur les nouvelles relations internationales. En promouvant la recherche, en menant des analyses fondées sur des données probantes, le projet contribuera à éclairer les dirigeants africains actuels et futurs à mieux comprendre les tendances du monde actuel et leurs implications pour la sécurité humaine et le développement humain de l’Afrique.
4-Axes thématiques du projet
Ce projet aborde de façon de non-exhaustive les axes thématiques suivants :
- La place de l’Afrique dans le système international,
- Le déclin de l’hégémonie des grandes puissances classiques en Afrique,
- L’Afrique au cœur de la compétition et des rivalités entre puissances traditionnelles et puissances émergentes /et les puissances émergentes elles-mêmes,
- La redéfinition des rapports entre les puissances traditionnelles et l’Afrique et ses implications sur le système monde,
- L’Afrique au cœur de l’alliance russo-chinoise,
- Dispositions, actions et engagements de la politique étrangère américaine de Trump 2.0 et impacts sur divers sujets d’intérêt dans les relations internationales/ leurs implications sur les relations afro-américaines,
- La question humanitaire face à Trump 2.0,
- Les politiques africaines des puissances émergentes classiques et des puissances émergentes nouvelles / les influences des puissances émergentes en Afrique,
- Partenariats en Afrique : puissances étrangères et souveraineté africaine,
- Les « émergents mous » d’Afrique,
- L’Afrique et les BRICS,
- Le positionnement des pays africains face aux nouvelles relations internationales / la place de l’Afrique dans les nouvelles relations internationales,
- Les puissances émergentes et le multilatéralisme en Afrique,
- La place de l’Afrique dans le Sud Global et le devenir de ses rapports avec l’occident,
- Afrique et renouvellement des partenariats internationaux dans le « nouvel ordre mondial,
- La coopération Afrique – BRICS+, une nouvelle voie vers le développement du continent africain ?
- L’Afrique et les organisations internationales,
- L’intégration régionale,
- La coopération afro-africaine,
- La place des acteurs non-étatiques dans les nouvelles relations internationales.
5-Résultats scientifiques
Le projet devrait produire plusieurs résultats : des ouvrages collectifs, articles dans les revues scientifiques de renommée, des articles de vulgarisation scientifique, la présentation des résultats lors des évènements scientifiques nationaux et internationaux, l’organisation des webinaires, etc.
6-Equipe de recherche :
Coordonnateur principal : Modeste MBA TALLA
Membres : Boris Metsagho Mekontcho, Brice Techimo Tafempa, Antoine Depadou Fouda, Saniou Njikam Mama, Ange Joachim Menzepo, Faraja Ciringa Albert.
Références bibliographiques
Africa Center for Strategic Studies, « La Russie en Afrique », disponible sur : https://africacenter.org/fr/focus-sur/russie-en-afrique/.
Badie Bertrand, (2016), Nous ne sommes plus seuls au monde. Un autre regard sur l’« ordre International », Paris, La Découverte.
Badie, Bertrand (2018), Quand le Sud réinvente le monde. Essai sur la puissance du faible, Paris, La découverte.
Badie, Bertrand et Vidal, Dominique, (2011), Nouveaux acteurs, nouvelle donne. L’état du monde 2012, Paris, La découverte.
Delamotte, Guibourg et Tellenne, Cédric (dir.) (2021), Géopolitique et géoéconomie du monde contemporain Puissance et conflits, Paris, La Découverte.
Deschaux-Dutard, Delphine et Lavorel, Sabine (eds.) (2017), Puissances émergentes et sécurité internationale : une nouvelle donne ? Une perspective pluridisciplinaire sur la puissance et l’émergence sur la scène internationale, Bruxelles, Peter Lang Group AG.
Garcin, Thierry (2018). La fragmentation du monde : La puissance dans les relations internationales. Paris, Economica.
Hurrell, Andrew (2006). « Hegemony, liberalism and global order: what space for would-be great powers?,”, International Affairs, 82.
Jaffrelot, Christophe (dir.) (2008), L’enjeu mondial. Les pays émergents, Paris, Presses de Sciences Po.
Keohane, Robert et Nye, Joseph (1977), Power and Interdependence. World Politics in Transition, New York/Boston/Toronto, Litte, Brown & Co.
Rosenau, James (1979), « Du touriste au terroriste, les deux extrêmes du continuum de la géopolitique », Études internationales, vol. 10, n° 2.
Santander, Sébastian (dir.) (2012), Puissances émergentes : un défi pour l’Europe ? Paris, Ellipses.
Santander, Sébastien (dir.) (2016). L’Afrique, nouveau terrain de jeu des émergents, Paris, Karthala.
Thierry de Montbrial et Dominique David (dir.), Entre puissances et impuissances, Paris, Dunod, 2025.
Ventura, Christophe (2023), « BRICS : vers un monde plus multipolaire ? », IRIS, Note d’actualité – décembre.